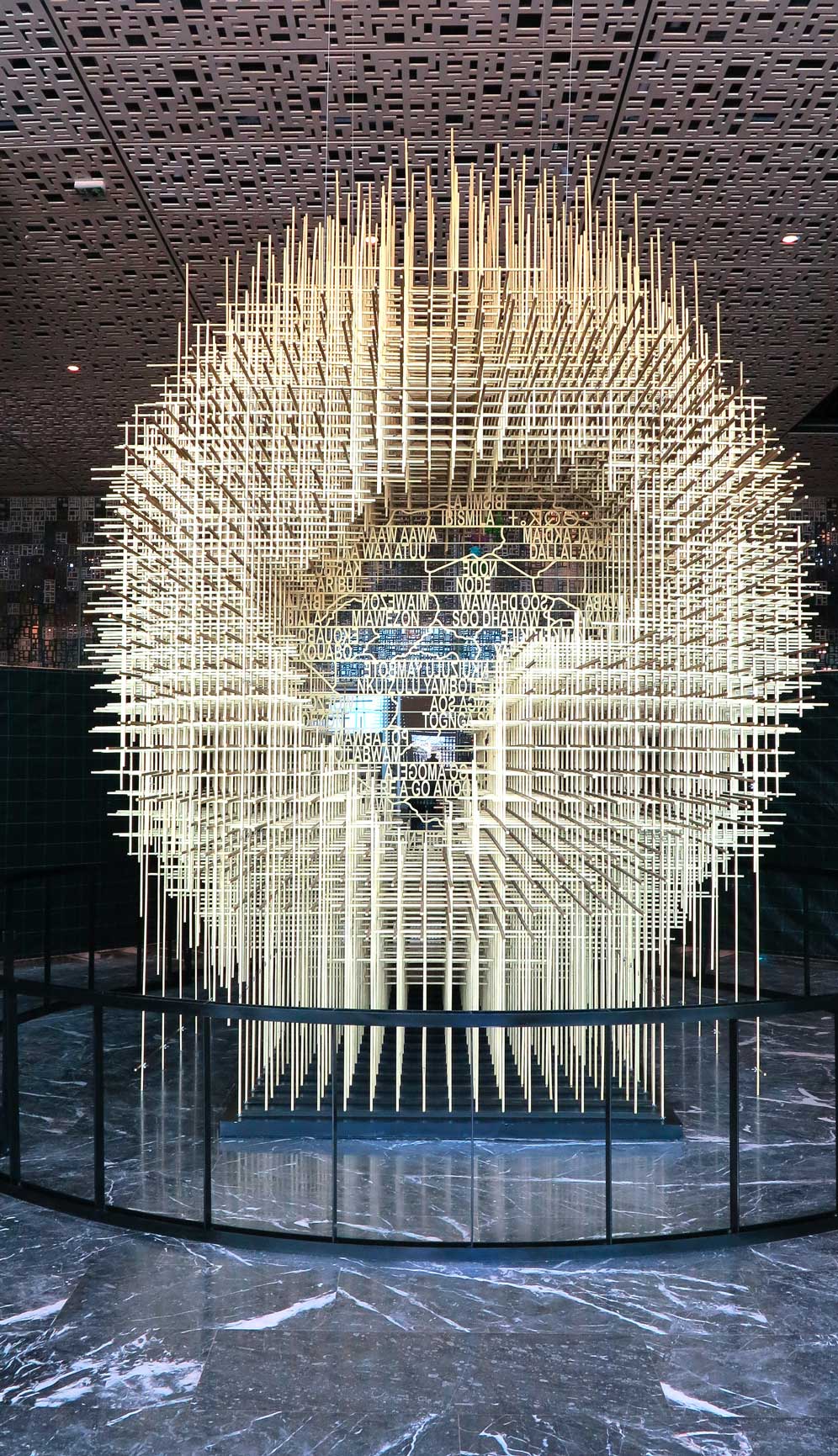La rédaction de diptyk se joint aux nombreuses voix endolories pour présenter toutes ses condoléances aux familles des victimes du séisme qui a frappé notre pays.
Nos pensées les accompagnent dans cette terrible épreuve.
Comme tout geste compte, voici une sélection d'associations ou d'initiatives auxquelles vous pouvez apporter votre soutien :